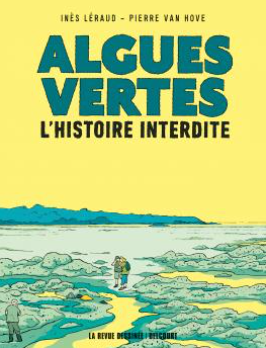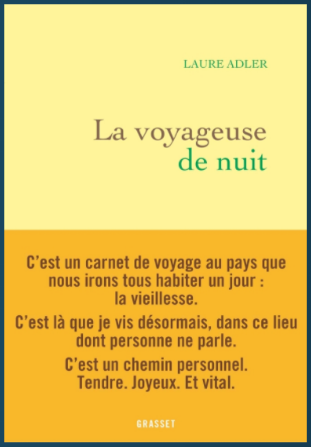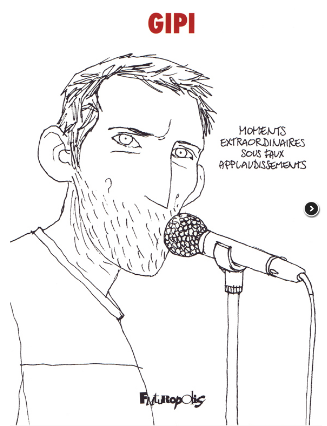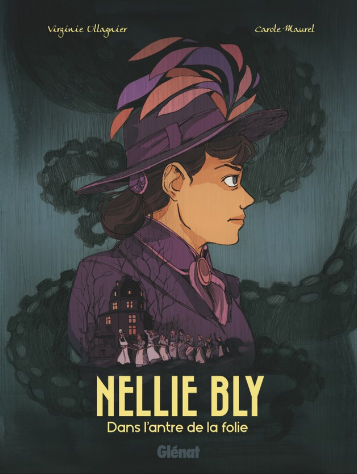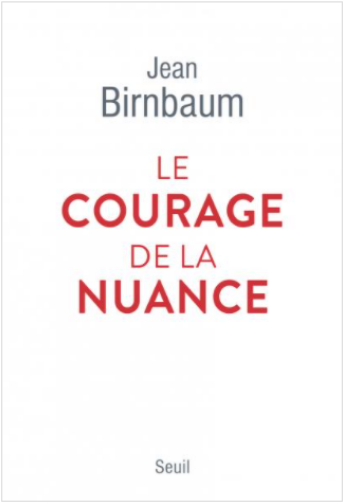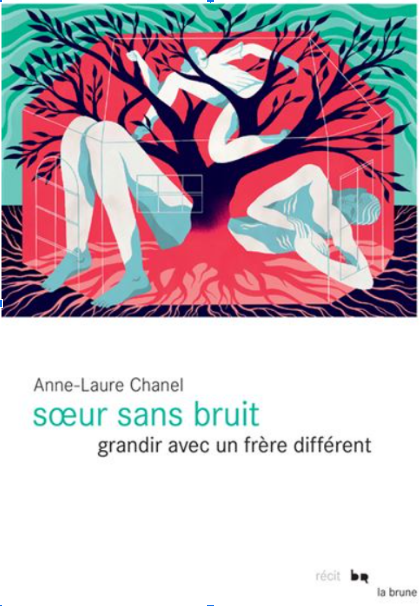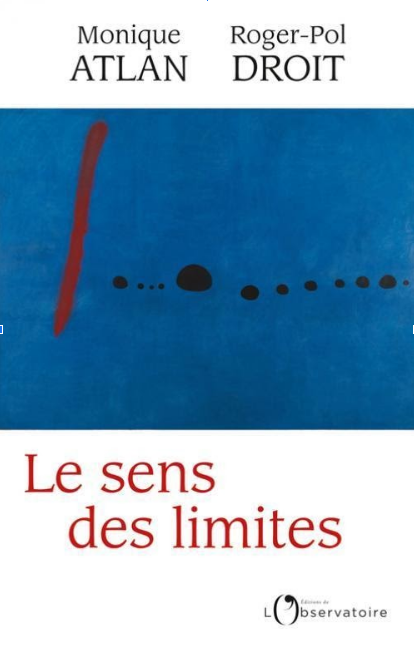Favoriser l’Autodétermination en établissement médico-social
Michèle LATU et Aurélie LE BARS,
Directrices ESMS| Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
Être acteur, participer, faire des choix, décider, faire valoir ses droits…
Sur le papier, ça a l’air bien mais pour les personnes en situation de handicap, ce n’est pas si simple.
Leur vécu du handicap avec son lot de difficultés et d’« incapacités » renvoyées par la société dans son ensemble nourrit, pour beaucoup d’entre elles, un sentiment d’incapacité : incapacité à avoir un appartement, incapacité à avoir une vie de couple et une vie de famille, incapacité à suivre une formation, ...
Au fil des épreuves et des discours peu encourageants, beaucoup se résignent à laisser les « autres » - leurs parents, leurs frères et sœurs, les professionnels les accompagnant - penser et mettre en musique ce qui serait a priori bon pour elles.
Ce processus de construction est alimenté par une institution qui, avec toute sa bienveillance, a mis en place, au fil des lois, un système de (sur)protection des personnes qu’elle accompagne, laissant alors peu de place à une véritable expression des besoins qui risquerait de mettre en péril ce système si bien rôdé.
Cette vie en institution a été pointée du doigt, en 2017, par la rapporteure de l’ONU, Catalina Devandas-Aguilar, pour laquelle « un bon établissement n’existe pas ». Ainsi, elle vient interroger le modèle français sur les questions de liberté, du choix, de l’autonomie, de la capacité à s’autoreprésenter, de la vulnérabilité et de la bientraitance. Elle précise, dans son rapport, qu’en France, « l’accent est mis sur la prise en charge de l'incapacité alors que les efforts devraient converger vers une transformation de la société et du cadre de vie, de sorte que toutes bénéficient de services accessibles et inclusifs et d'un soutien de proximité ». Un « cloisonnement qui ne fait qu'entretenir une fausse image des personnes handicapées », à « prendre en charge plutôt que comme des sujets de droit. »
C’est dans ce contexte et en tant que directrices d’établissements médico-sociaux que nous nous sommes interrogées sur la façon de faire évoluer nos établissements pour donner, au sein de ce système, une véritable place d’acteur.trice de leur vie aux personnes que nous accompagnons.
Pour cela, un premier programme de formation basé sur les droits des personnes en situation de handicap au regard de la convention de l’ONU et sur l’Autodétermination a été mis en place entre 2018 et 2019. Des personnes concernées et des professionnels ont pu bénéficier de ce premier programme.
Les résultats sont venus confirmer notre hypothèse qu’augmenter l’Autodétermination des personnes leur permettrait d’agir sur leur environnement. Elles osent davantage s’exprimer et faire valoir leurs droits en termes d’inclusion et ainsi ont une réelle action sur le fonctionnement des établissements mais aussi sur notre société dans son ensemble.
Au sein d’une institution, il est important que cette démarche soit partagée et soutenue. Les personnes doivent être encouragées dans leurs initiatives. Comme dans un processus d’apprentissage et de développement, il est primordial d’accompagner les échecs et non de les éviter pour que ceux-ci deviennent expériences et permettent à la personne d’aller plus loin.
Si les établissements demeurent une solution pour bon nombre de personnes en situation de handicap dans la société telle que nous la connaissons aujourd’hui, il n’en demeure pas moins que les pratiques d’accompagnement et le regard que nous portons tous sur les personnes en situation de handicap doit évoluer.
Nous ne sommes qu’aux prémices d’un processus mené par les personnes elles-mêmes. Plus cette dynamique sera essaimée au sein des établissements médico-sociaux, dans les formations des futurs professionnels et dans d’autres secteurs et plus les personnes elles-mêmes auront les moyens d’agir sur le caractère inclusif de notre société.
Vivre ensemble et non plus l’un à côté de l’autre renforcera les relations humaines. Les différences des uns et des autres seront ainsi plus facilement acceptables, compréhensibles et supportables. C’est une fois que la personne en situation de handicap vit dans la cité et tient une réelle place de citoyen que l’adaptation prend tout son sens et qu’une collaboration entre tous peut prendre racine.